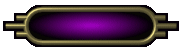Fonctionnement du Satellite
texte et images provenant de : www.webencyclo.com, ©Webencyclo des Éditions Atlas 2001 - Tous droits réservés
Un environnement
particulier
Les satellites artificiels sont très différents par leurs dimensions,
par leurs formes, par leurs rôles. Ils sont cependant composés des mêmes
éléments qui leur permettent de fonctionner dans les conditions
particulières du milieu spatial. Ces singularités sont : le vide presque
parfait ; le rayonnement solaire qui chauffe fortement un côté du
satellite pendant que le côté opposé est au contraire très froid ;
l'isolement physique complet avec la Terre, qui fait des ondes
radioélectriques le seul moyen de communication possible, et qui
interdit toute réparation d'un satellite automatique (c'est-à-dire sans
équipage) ; la liberté totale de mouvement du satellite autour de son
centre de gravité, qui se déplace lui-même sur une trajectoire
entièrement déterminée par les lois de la mécanique céleste.
Le système de
contrôle thermique
Le vide spatial n'est pas en lui-même un sérieux problème : les
appareils électroniques fonctionnent très bien dans ces conditions, et
seuls les vaisseaux spatiaux habités ont besoin d'une atmosphère
artificielle où les astronautes peuvent respirer et vivre sans
scaphandre. La différence des températures entre la face éclairée et
celle à l'ombre constitue en revanche une difficulté sérieuse : elle
peut dépasser 200°C. En outre, un satellite proche de la Terre peut
rester à chaque révolution plusieurs dizaines de minutes dans l'ombre de
la planète, c'est-à-dire dans le froid cosmique. Pour résoudre ces
problèmes, un satellite dispose d'un système de contrôle thermique, qui
l'isole des rayons solaires, évacue les calories excédentaires produites
par les appareils électroniques, et maintient une température
satisfaisante dans tout le satellite. Ce système comprend un écran
thermique (en général des couches d'un matériau comme le Kevlar
aluminisé, dans lequel le satellite est comme emmailloté) et des
radiateurs que l'on ouvre plus ou moins en fonction des besoins.
Le système de
stabilisation et de manœuvre
Ce second élément important d'un satellite artificiel comprend des
petits moteurs-fusées (ou même simplement des petites tuyères éjectant
du gaz sous pression) qui permettent d'orienter l'engin dans l'espace,
de l'empêcher de tourner sur lui-même comme une toupie incontrôlée et,
le cas échéant, de modifier sa trajectoire. Des roues à inertie,
c'est-à-dire des sortes de gros>gyroscopes, servent aussi à maintenir un
axe dans une direction déterminée. Un satellite de télécommunications
géostationnaire, par exemple, doit maintenir ses antennes dirigées vers
des points précis du globe terrestre. Il doit aussi corriger
régulièrement les perturbations que subit son orbite du fait que la
Terre n'est pas une sphère parfaite et homogène, et aussi à cause de
l'attraction du Soleil.
Le système
d'alimentation en énergie
Ce système est la troisième partie fondamentale d'un satellite. La
plupart des engins spatiaux utilisent l'énergie solaire, qu'ils
transforment directement en électricité au moyen de photopiles.
Celles-ci sont des jonctions semi-conductrices qui fournissent un
courant lorsqu'elles sont éclairées. On les dispose en général sur des
panneaux solaires, qu'un dispositif d'orientation maintient
perpendiculaires aux rayons du Soleil. Ces panneaux donnent souvent aux
satellites l'aspect de grands papillons. Les photopiles ne fonctionnent
cependant pas dans l'ombre de la Terre et elles ne peuvent pas toujours
faire face à des pics dans la demande électrique du satellite. Celui-ci
dispose donc en outre de batteries, c'est-à-dire de piles qui sont
rechargées par l'électricité des panneaux solaires. Certains engins
spatiaux, ayant une durée de vie courte, n'utilisent d'ailleurs que des
batteries comme sources d'énergie. C'est le cas par exemple des
vaisseaux de transport d'astronautes, comme le Soyouz russe, ou la
navette spatiale américaine. Celle-ci fait appel à une technologie très
avancée : les piles à combustible, qui consomment de l'hydrogène et de
l'oxygène liquides pour produire de l'électricité (et de l'eau) dans un
processus inverse de celui de l'électrolyse de l'eau.
Le système de
commande et de contrôle
Ce système, véritable " cerveau " de l'engin spatial, dirige toutes
les actions du satellite. Il surveille l'état des différents éléments du
satellite et transmet les informations correspondantes au centre de
contrôle situé sur la Terre. Inversement, il reçoit les ordres du centre
du contrôle sur les manœuvres et le travail que doit accomplir le
satellite, et il assure l'exécution de ces tâches. Cet échange
d'informations entre la Terre et le satellite est appelé télémétrie.
S'il s'interrompt, le satellite est perdu.
La charge utile
Un satellite emporte naturellement aussi une charge utile qui lui
permet de réaliser sa mission. Il peut s'agir d'un télescope pour
observer l'Univers, d'une caméra pour photographier la Terre ou de
"répéteurs" pour relayer des télécommunications, par exemple.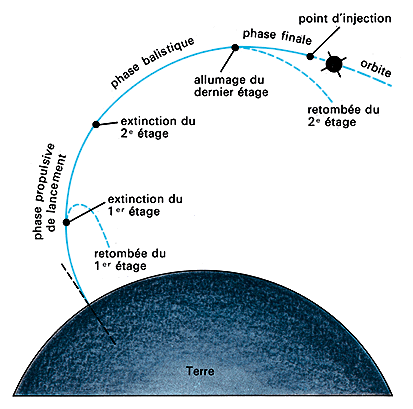
Images et shémas
Schéma illustrant les différentes phases du lancement.
La vitesse tangentielle et l'altitude du satellite au point
d'injection, lorsque celui-ci est abandonnéà lui-même, conditionnent les
caractéristiques de l'orbite.
©A-CL
texte et images provenant de : www.webencyclo.com, ©Webencyclo des Éditions Atlas 2001 - Tous droits réservés

Explication schématique du fonctionnement d'un Satellite de télécommunication :
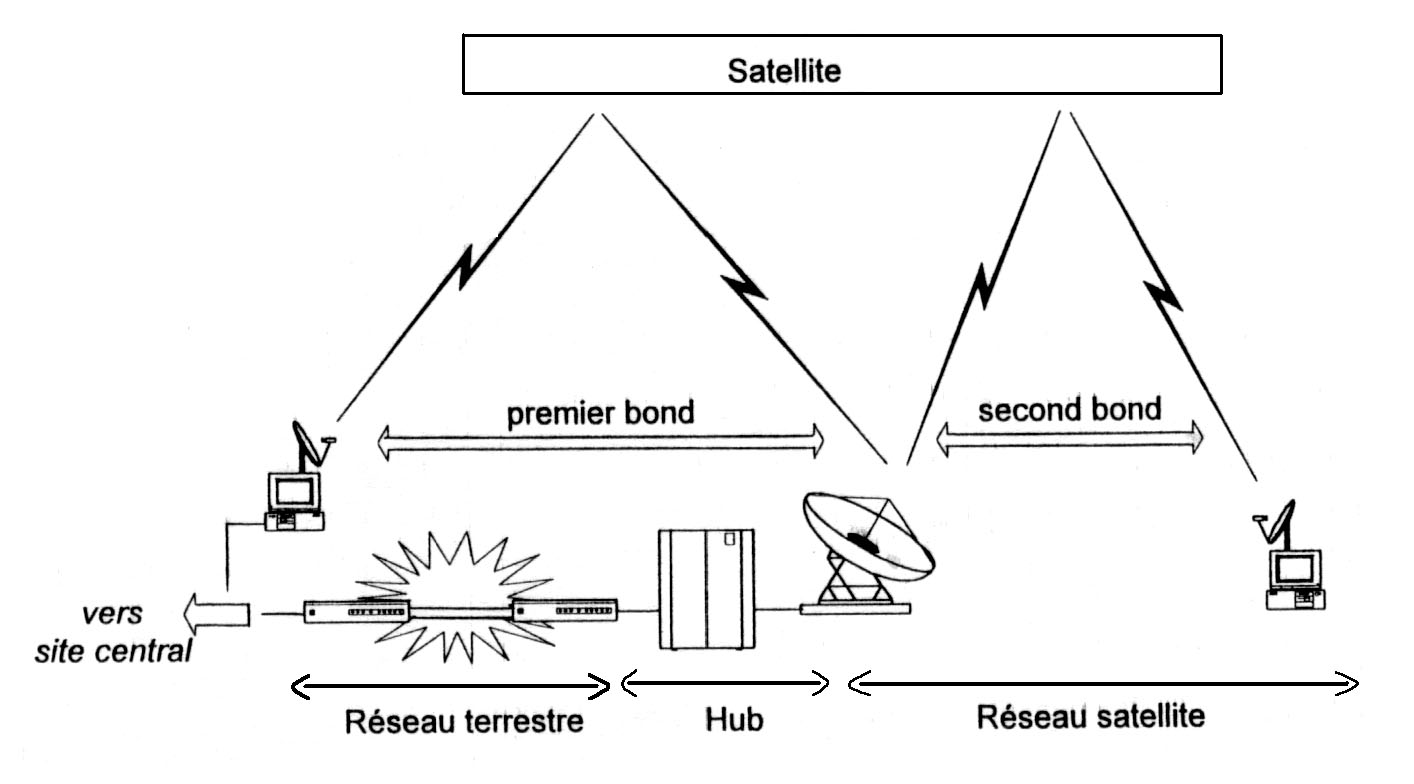
|
Mise a jour de la page le 03/2005 |

![]()